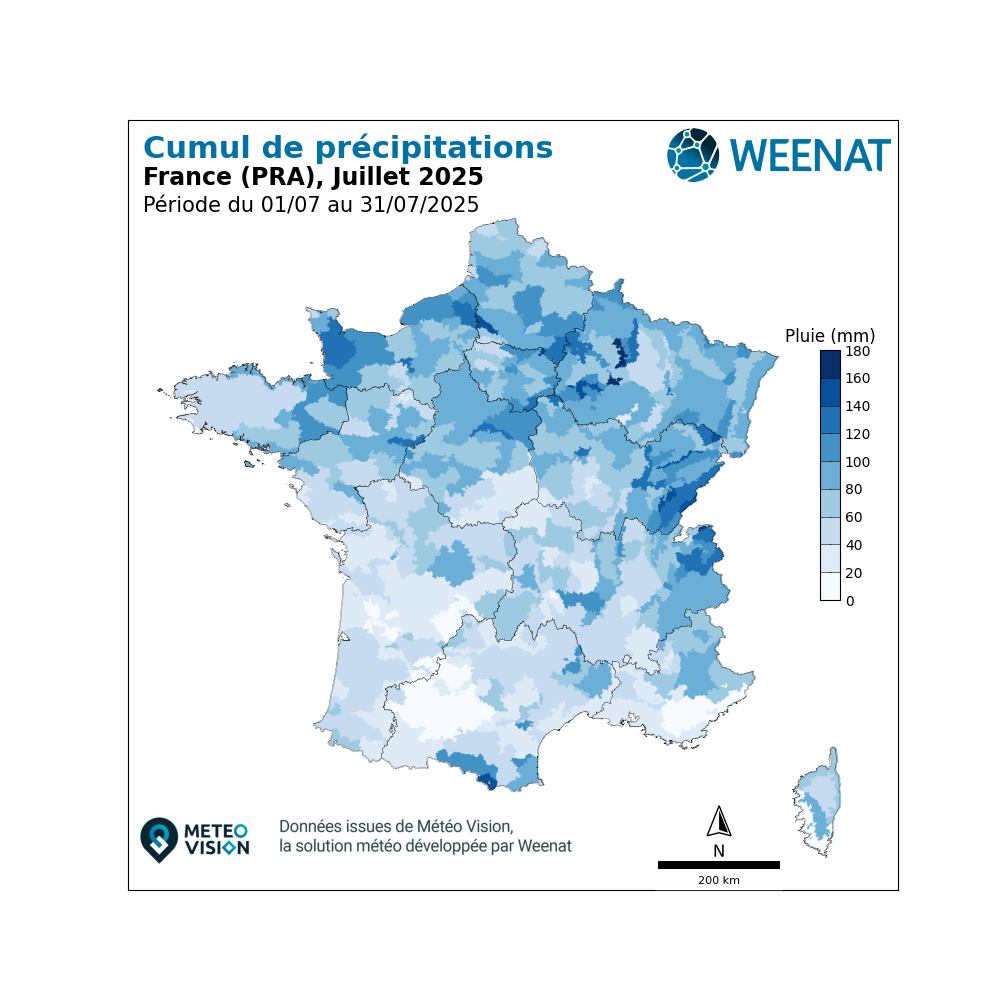Sur le papier, la France ne manque pas d’eau :
➡️ Environ 2 000 milliards de m³ d’eau souterraine répartis dans un vaste réseau de nappes phréatiques.
➡️ Un système complexe de ressources en eau comprenant des eaux de surface et des réserves souterraines.
➡️ Et 400 milliards de m³ d’eau de pluie chaque année alimentant le cycle de l’eau naturel.
Pourtant, les faits sont là face au changement climatique :
Sur les cinq dernières années, le pays a connu quatre épisodes de sécheresse majeurs. Le dernier en date : 2022. Au 15 août 2022, 80% du territoire national était en situation de stress hydrique critique, avec des conséquences dramatiques sur la production agricole et l’approvisionnement en eau potable de nombreuses régions.
La situation est encore plus critique au niveau mondial. Selon les prévisions du World Resources Institute, 33 pays risquent des pénuries d’eau d’ici 2040 notamment en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’augmentation de la population mondiale et la croissance démographique exercent une pression croissante sur les ressources disponibles. Le manque d’eau devrait s’accentuer sur plus de 80 % des terres cultivées dans le monde, avec un impact majeur sur la sécurité alimentaire de plusieurs milliards d’habitants.
Pour les agriculteurs de France et d’ailleurs, il s’agit d’un défi technique sans précédent lié au réchauffement climatique. Car sans eau, pas d’agriculture viable. C’est un phénomène qui pourrait impacter toutes les populations, créer des tensions géopolitiques et générer des conflits pour l’accès aux ressources hydriques. L’Organisation des Nations Unies estime qu’un tiers de la population mondiale pourrait être confronté à un déficit hydrique d’ici 2050. Heureusement, il existe des solutions pour protéger votre récolte contre le stress hydrique et développer une gestion durable de l’eau.
Qu’est-ce que le stress hydrique ? Définition, causes et conséquences.
Les plantes rejettent dans l’atmosphère la quasi-totalité de l’eau qu’elles absorbent. Le principe est le suivant : pour permettre la respiration cellulaire, la plante ouvre ses stomates, c’est-à-dire les pores de ses feuilles. L’eau présente dans les feuilles se retrouve alors au contact de l’air, et s’évapore rapidement, particulièrement lors de fortes températures.
On parle de stress hydrique, ou stress osmotique, lorsque la quantité d’eau transpirée par la plante est supérieure à la quantité d’eau qu’elle absorbe du sol. Cette situation de déséquilibre hydrique entraîne une dégradation des fonctions vitales de la végétation. Si la situation dure trop longtemps, la croissance végétative du végétal (arbres, plantes, cultures) sera directement impactée, avec une perte de rendement significative.
Plusieurs paramètres agro-météo peuvent impacter le stress hydrique et modifier l’état des ressources en eau :
• Les fortes chaleurs et les canicules, qui impactent le rechargement des nappes souterraines et augmentent l’évaporation
• La présence de vent fort, qui accélère la transpiration des plantes
• Une faible hygrométrie atmosphérique, facteur critique d’aridité
• L’humidité du sol et sa capacité de rétention
• La diminution de la pluviométrie et le manque de précipitations hivernales
• La salinité du milieu, particulièrement près des côtes où l’eau de mer peut contaminer les eaux souterraines
Ces facteurs multiples, exacerbés par le changement climatique et l’effet de serre, créent des conditions extrêmes qui touchent particulièrement les zones agricoles. La France, notamment la Côte d’Azur et la Vendée, connaît des périodes de plus en plus longues de déficit hydrique, avec des conséquences sur l’ensemble de l’environnement.
Comment lutter contre le stress hydrique ? Les solutions.
Il existe plusieurs solutions techniques pour protéger votre récolte contre le stress hydrique et améliorer la gestion de l’eau agricole. Voici 5 méthodes dont l’efficacité n’est plus à prouver face aux enjeux de la raréfaction des ressources hydriques.
1. La sélection variétale
Tous les végétaux ne sont pas égaux face au stress hydrique. En fait, les plantes ont développé plusieurs stratégies pour survivre au manque d’eau et s’adapter aux conditions de sécheresse :
➡️ L’évitement :
La plante réalise son cycle végétatif en dehors des périodes de sécheresse, modifiant naturellement son développement pour éviter les phases critiques.
➡️ L’esquive :
La plante développe son système racinaire en profondeur ou réduit sa transpiration en refermant une partie de ses stomates pour limiter les pertes d’eau.
➡️ La tolérance :
Certaines espèces sont naturellement résistantes au stress hydrique et parviennent à préserver leur surface foliaire, même lorsque l’eau se fait rare dans le sol.
Une partie importante du travail des instituts de recherche agronomique consiste à identifier les espèces et les variétés les mieux à même de résister au stress hydrique. Cette démarche d’amélioration génétique permet de développer des cultures adaptées aux nouvelles conditions climatiques.
Dans les prairies, certains agriculteurs ont par exemple fait le choix d’implanter davantage de luzerne (Medicago sativa), une plante méditerranéenne qui utilise la stratégie de l’esquive. Ses racines peuvent se développer jusqu’à 4 mètres de profondeur pour puiser l’eau dans les couches profondes du sol, accédant ainsi aux réserves souterraines.
Tout comme eux, vous pouvez adapter vos rotations culturales pour booster la résilience de votre exploitation face au stress hydrique et réduire les risques de perte de production.
2. Les leviers agronomiques
Sur le plan agronomique, plusieurs bonnes pratiques permettent de réduire la sensibilité des végétaux au stress hydrique, et de conserver l’eau dans les sols tout en préservant leur qualité.
➡️ Les dates de semis :
C’est souvent durant la phase de floraison que vos cultures sont le plus sensibles au manque d’eau. Et tout stress hydrique prolongé durant cette période critique risque d’avoir un effet fort sur le nombre de grains et la formation des organes reproducteurs.
Par contraste, un stress tardif n’impactera que le remplissage des graines, et sera donc moins préjudiciable pour le rendement final. Alors pour éviter que la période de floraison ne se déroule pendant l’été, lorsque le risque de stress hydrique est élevé et que la demande en eau est maximale, de nombreux agriculteurs font le choix d’avancer leurs dates de semis.
Ces semis précoces constituent un levier agronomique simple et efficace pour lutter contre le stress hydrique, comme l’a prouvé un essai réalisé en Moselle (57) par Terres Inovia : un premier semis a été réalisé le 25 février. Le second semis, effectué un mois plus tard, a généré 6 à 10 q/ha de rendement en moins, illustrant l’importance de cette technique face aux aléas climatiques.
➡️ Le désherbage :
Les adventices présentes sur vos parcelles peuvent entrer en concurrence avec la culture en place pour les ressources en eau et en éléments minéraux. Cette compétition pour l’usage de l’eau disponible peut se traduire par une réduction de la vigueur, voire une baisse significative du rendement. Pour préserver vos plantes contre le stress hydrique, vous pouvez appliquer des traitements localisés, ou recourir au désherbage mécanique, techniques qui limitent la consommation d’eau par les espèces indésirables.
➡️ Les rotations culturales :
Afin de maximiser la capacité de rétention de vos sols et d’améliorer leur structure, veillez à diversifier vos rotations culturales, en introduisant par exemple des cultures intermédiaires, ou des couverts associés riches en matière organique. Cette pratique améliore la porosité du sol et sa capacité à retenir l’eau lors des précipitations. Vos sols seront plus riches, mieux structurés, et vos cultures auront de meilleures chances de résister au stress hydrique grâce à une meilleure exploitation des ressources du milieu.
3. Les sondes de pilotage de l’irrigation
Pour lutter contre le stress hydrique, il faut d’abord le mesurer avec précision. Et les sondes de pilotage de l’irrigation sont l’un des meilleurs outils pour y parvenir et optimiser la gestion de cette ressource précieuse.
Concrètement, des capteurs sont installés au plus près de vos cultures, et mesurent la disponibilité en eau des sols en temps réel. Les données sont ensuite transférées vers votre téléphone ou votre ordinateur via des systèmes connectés. Ainsi, vous savez d’un simple coup d’œil si vos plantes ont suffisamment d’eau, et vous pouvez optimiser vos irrigations selon les besoins réels. C’est un gain de temps considérable, et c’est économique car cela permet de réduire le gaspillage !
Dans le détail, il existe deux principaux types de sondes pour suivre le risque de stress hydrique sur vos parcelles et adapter l’utilisation de l’eau :
LES SONDES CAPACITIVES
Elles mesurent la teneur en eau volumique, c’est-à-dire la part d’eau contenue dans un volume de sol donné. La valeur est traduite en un pourcentage d’humidité du sol, permettant une analyse précise de l’état hydrique.
LES SONDES TENSIOMÉTRIQUES
Elles mesurent le potentiel hydrique matriciel, c’est-à-dire la force que doivent exercer les racines pour extraire l’eau du sol. Le résultat est exprimé en kPa. Plus la valeur est élevée, plus la tension est forte, et moins il y a d’eau disponible pour les plantes, indiquant un niveau critique.
Toutes deux ont leurs mérites dans le cadre d’une gestion raisonnée de l’eau. Toutes deux ont leurs limites selon le type de sol et de culture. Et toutes deux fonctionnent selon des principes tout à fait différents. Pour faire le bon choix et éviter les problèmes techniques, vous pouvez consulter notre guide sur le pilotage de l’irrigation.
4. Les outils d’aide à la décision
Autre solution technologique : il existe aujourd’hui des outils d’aide à la décision (OAD) capables de modéliser les besoins en eau d’une culture en fonction de paramètres agro-météorologiques complexes comme :
- La pluviométrie et la répartition des précipitations
- L’évapotranspiration potentielle et réelle
- La Réserve Facilement Utilisable (RFU) du sol
- Le stade cultural et les besoins spécifiques de chaque phase ;
- La température et les variations saisonnières
- L’humidité atmosphérique et les conditions climatiques
Ces outils sont appelés des bilans hydriques, et ils permettent de suivre l’état de la réserve en eau de vos sols avec une grande précision. Ainsi, vous savez OÙ et QUAND vos plantes ont besoin d’eau selon leur stade de croissance. Et vous pouvez lutter efficacement contre le déficit hydrique en anticipant les périodes critiques.
Vous voulez aller toujours plus loin dans la précision ?
Weenat a également développé Weedriq, le premier OAD capable de vous indiquer, avec précision, comment l’état hydrique de vos sols va évoluer durant les 7 prochains jours. Cet outil révolutionnaire permet une gestion prédictive de l’eau, particulièrement utile face aux tendances climatiques actuelles.

Prévisions Weedriq sur l’application Weenat
5. Les biostimulants
En vue de lutter contre les stress abiotiques, comme le gel, le vent ou la sécheresse, de plus en plus d’agriculteurs s’intéressent aux biostimulants dans le cadre d’une agriculture durable. Ces substances, souvent issues de composés naturels et organiques, sont conçues pour booster le développement des plantes et améliorer leur résistance, même en conditions difficiles.
Une molécule, en particulier, a permis d’obtenir de premiers résultats encourageants contre le stress hydrique. Il s’agit des phytostérols, une substance qui prépare la plante au manque d’eau et améliore sa capacité d’adaptation. Elle provoque notamment le resserrement des stomates pour limiter les pertes d’eau, et stimule la croissance des racines pour une meilleure exploration du sol.
Ces techniques biologiques représentent une approche complémentaire aux méthodes traditionnelles et s’inscrivent dans une démarche de préservation des ressources naturelles.
Pour une agriculture plus résiliente :
Vous l’avez compris, le stress hydrique de la plante est un véritable fléau pour votre production et pour l’agriculture de manière générale. Les sécheresses risquent de devenir plus fréquentes avec l’évolution du climat global et l’augmentation des températures. La situation s’aggrave particulièrement dans certaines zones touchées comme l’Europe du Sud, où la probabilité de stress hydrique ne cesse d’augmenter.
Mais le manque d’eau n’a rien d’une fatalité. Et comme on l’a vu, des solutions existent pour y faire face et développer une exploitation raisonnée des ressources hydriques :
➡️ Vous pouvez optimiser la gestion des ressources en eau : utilisation de sondes de pilotage, outils d’aide à la décision, bonnes pratiques agronomiques, sobriété dans les usages, recyclage de l’eau…
➡️ Ou utiliser des techniques pour améliorer la résistance et la conservation des cultures : sélection variétale, biostimulants, amélioration de la structure du sol, protection contre l’évaporation, réutilisation des eaux usées traitées selon les normes en vigueur…
La stratégie la plus efficace consiste à combiner plusieurs méthodes dans une approche globale et intégrée. Cette démarche permet de réduire les risques, limiter l’impact environnemental, et obtenir les meilleurs résultats possibles face aux défis du changement climatique.
Libre à vous de choisir les techniques qui correspondent le mieux aux besoins de votre exploitation et aux spécificités de votre région. Mais n’attendez pas la prochaine sécheresse pour agir. L’anticipation et la mise en place de solutions préventives sont essentielles pour maintenir une production agricole durable face à la crise de l’eau qui s’annonce à l’échelle planétaire.